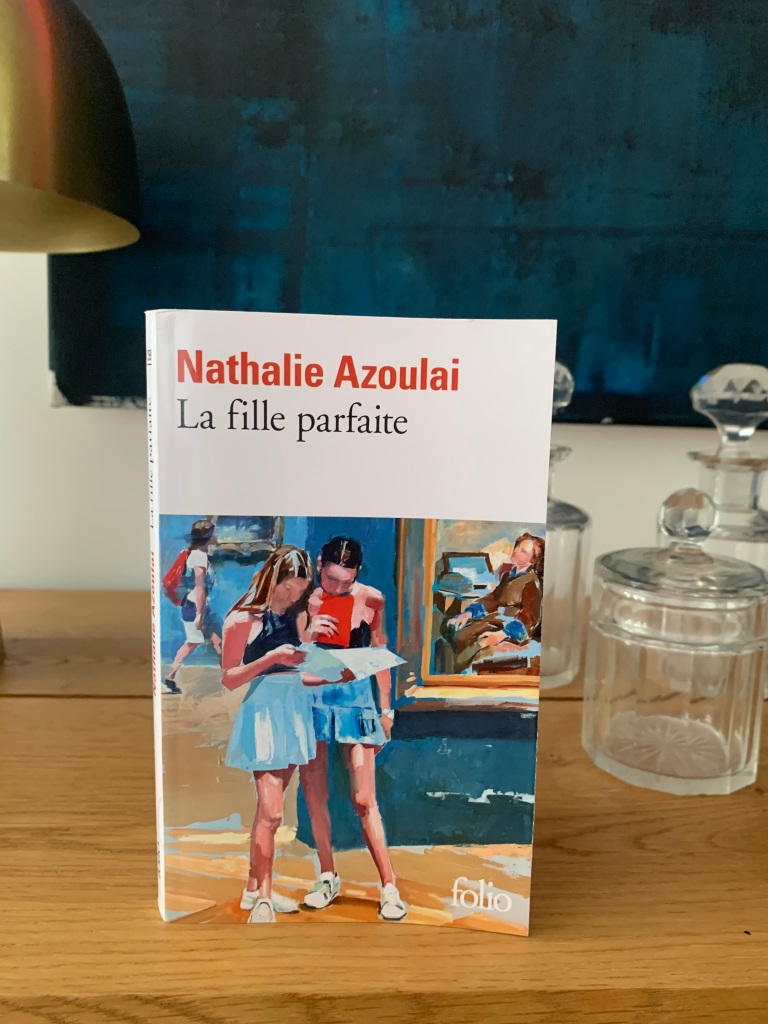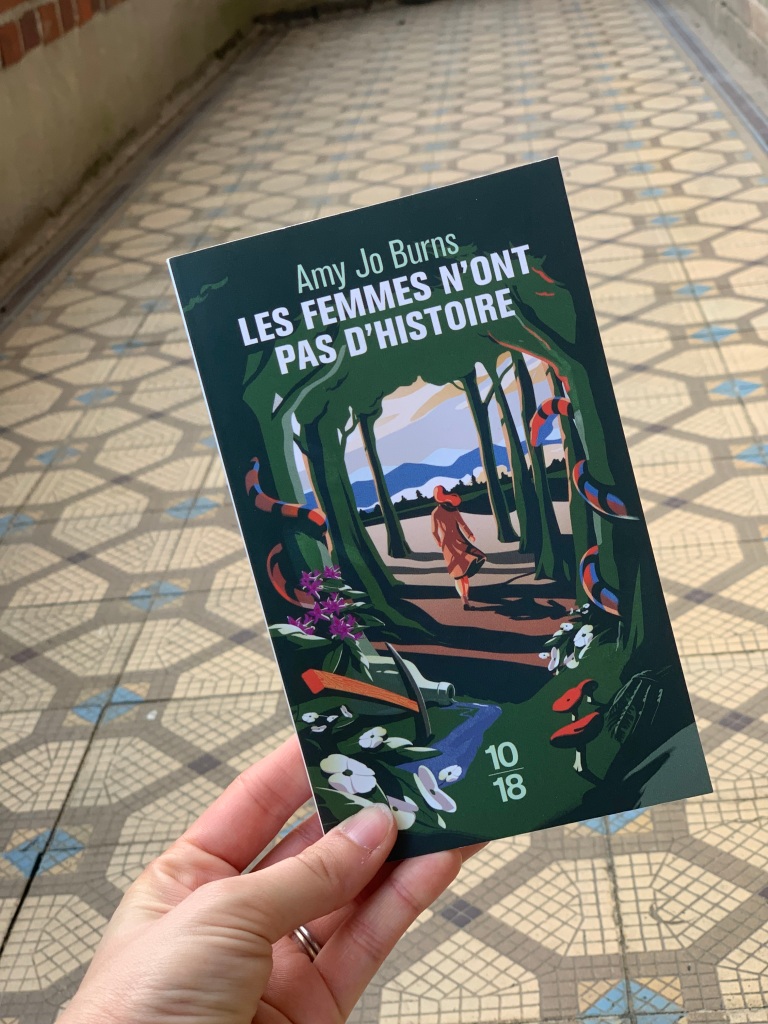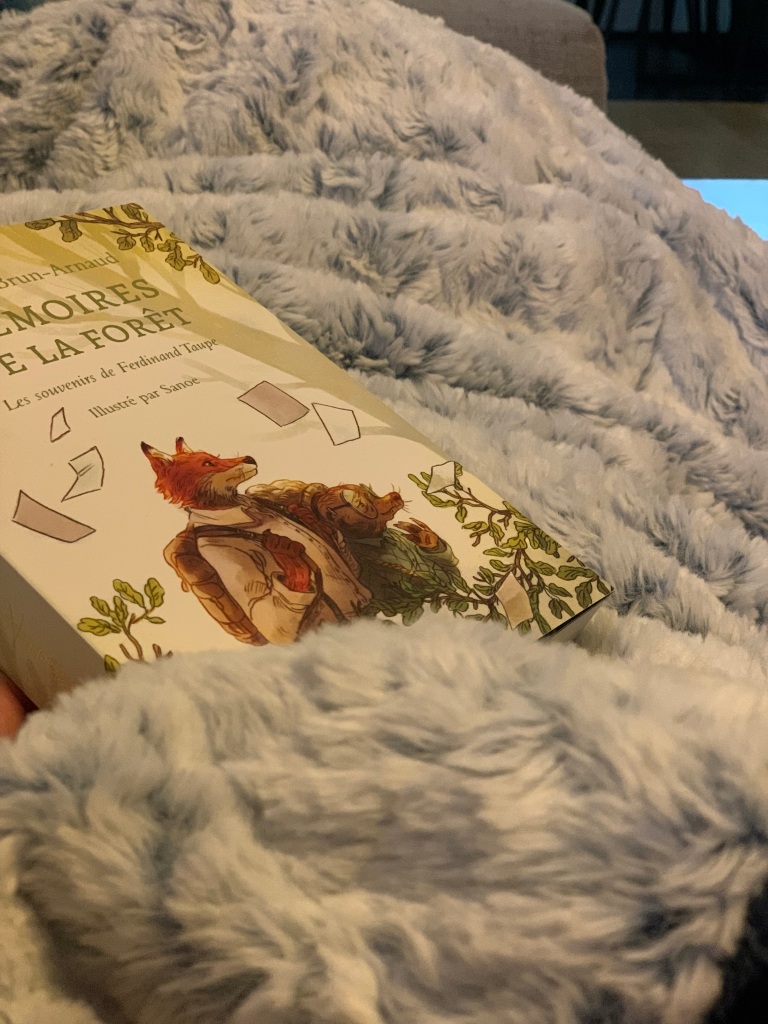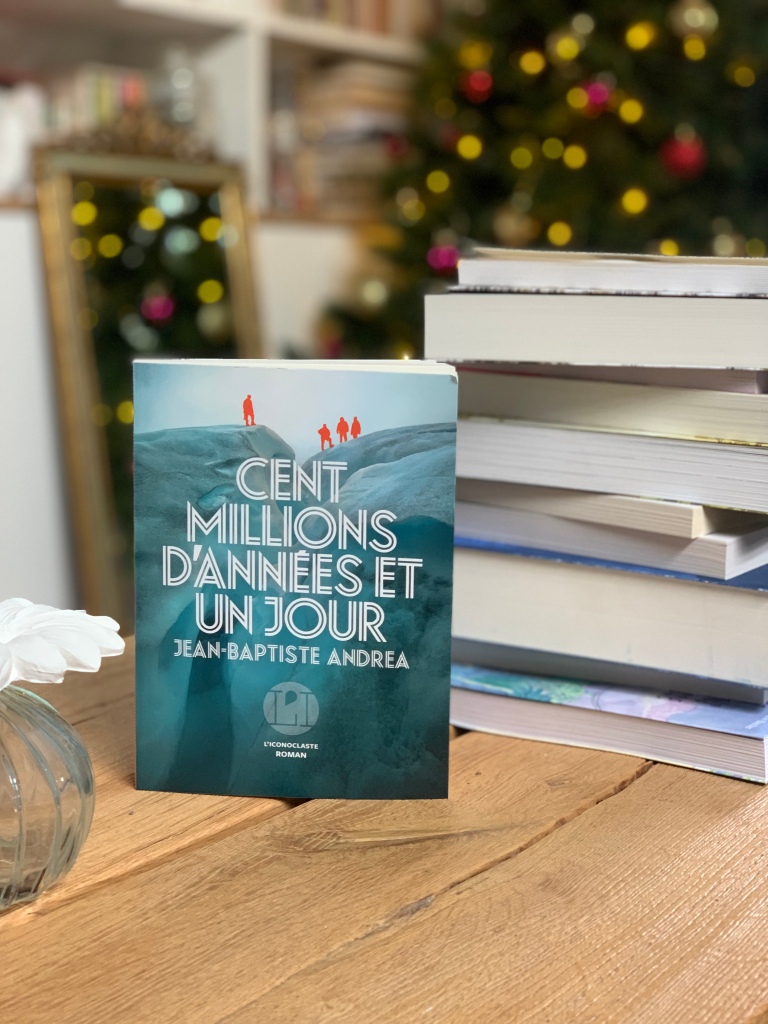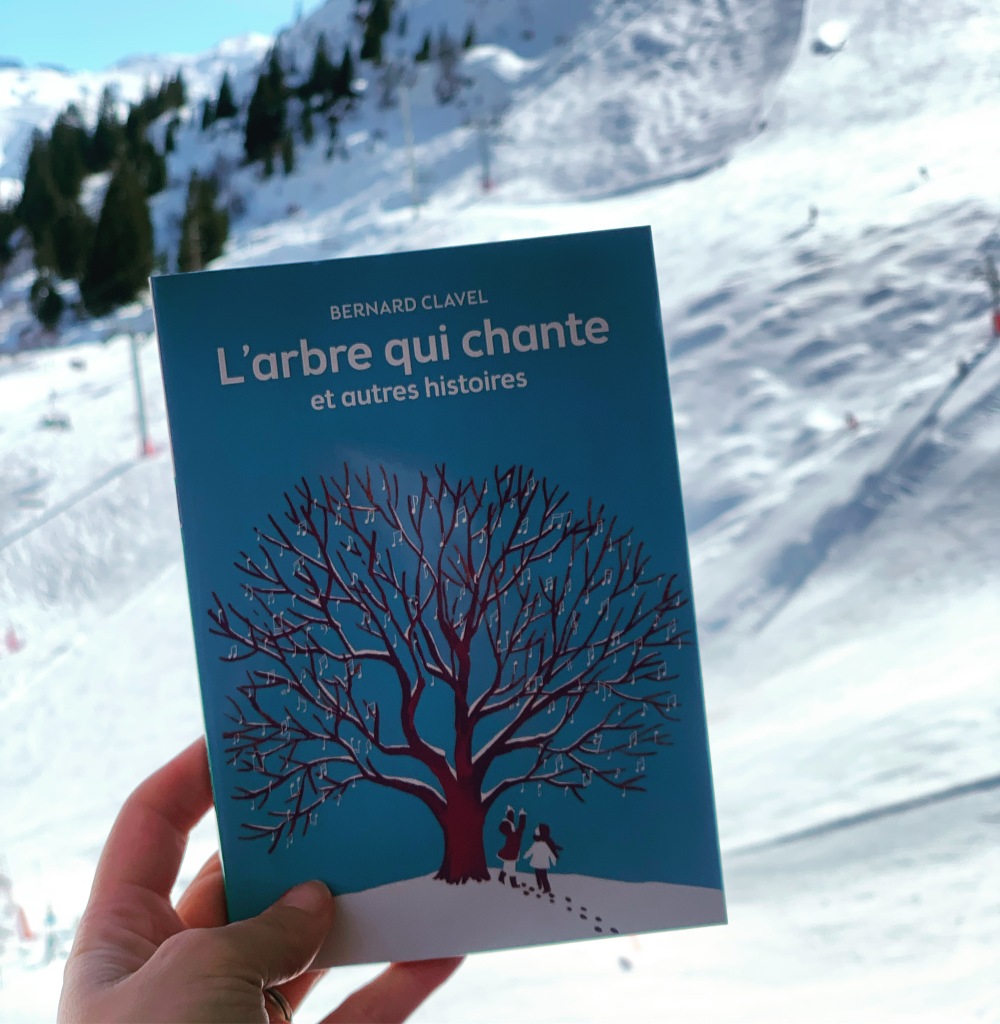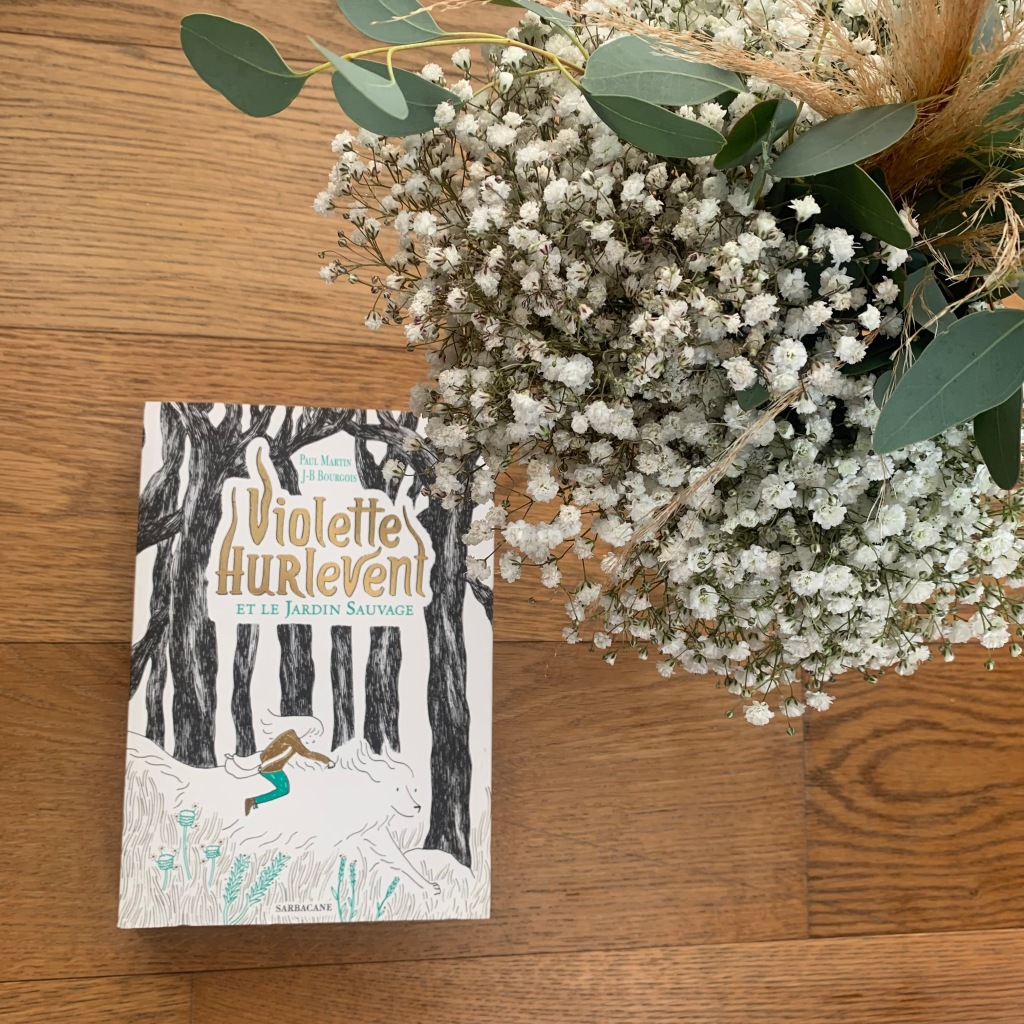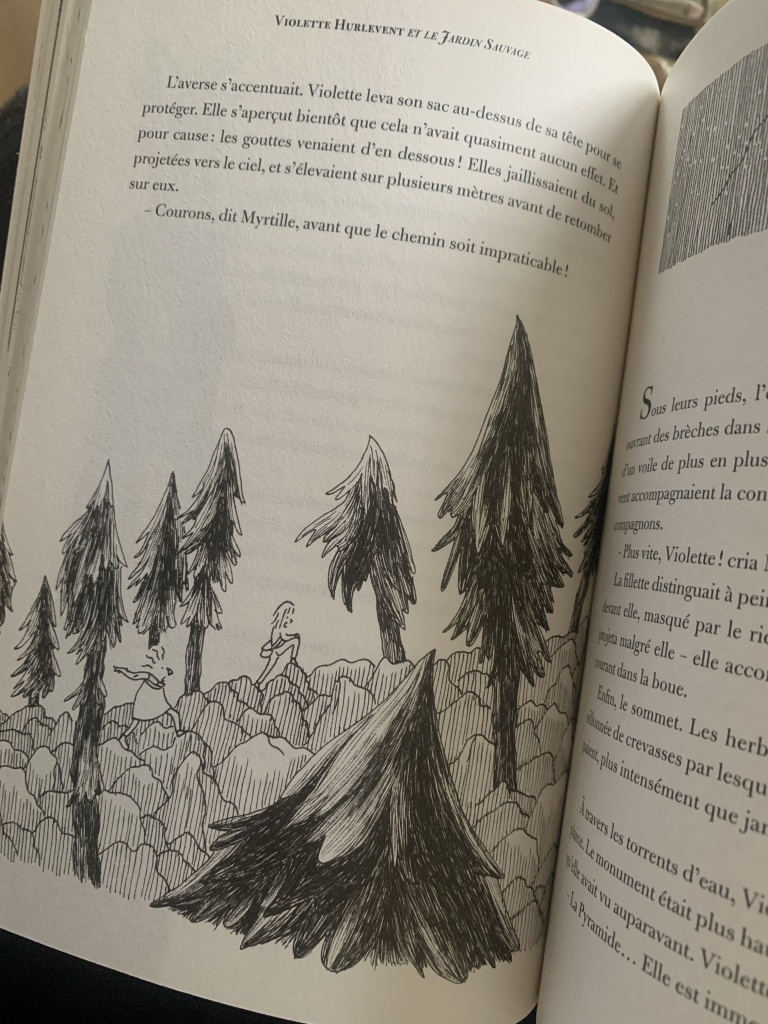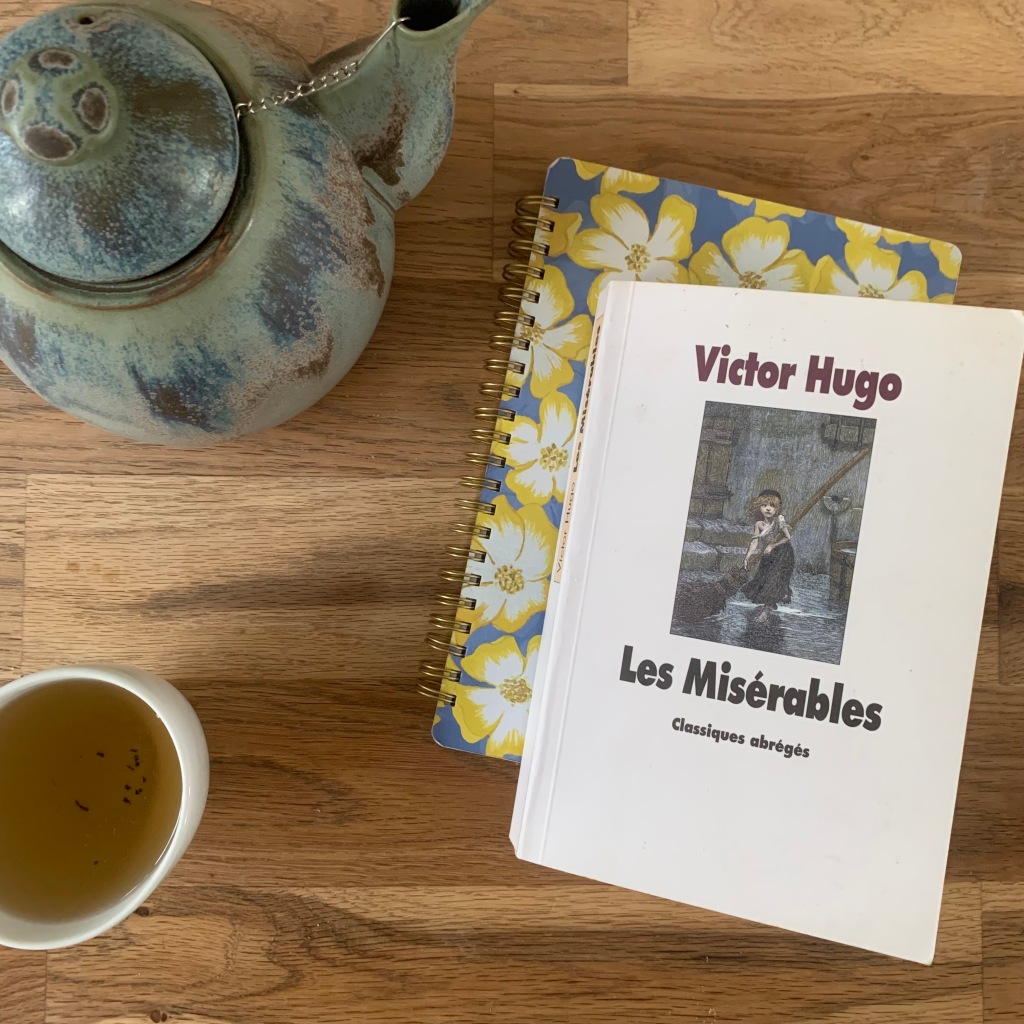« Pourquoi est-ce qu’ Adèle Prinker avec ses médailles, sa gloire, sa blondeur, tous les signes apparents du bonheur, pourquoi Adèle Prinker s’était-elle donc pendue chez elle un beau matin de juin à l’âge de quarante-six ans ? » Voilà le postulat de départ, intriguant, je m’attendais donc à un récit haletant et finalement j’ai trouvé le rythme lent.
Le récit est mené par l’amie restée en vie, Rachel. Dans ce récit d’une amitié fusionnelle, la relation entre Rachel et Adèle est au centre de l’histoire, elles sont à la fois contraires et complémentaires. Rachel Deville et Adèle Prinker sont deux très grandes amies mais elles choisissent après le lycée deux voies opposées : l’une fera des études de lettres et l’autre de mathématiques. Cette orientation est en grande partie déterminée par leurs familles, les Deville sont de grands bourgeois, héritiers des salons littéraires. Les Prinker sont issus d’un milieu social plus modeste et estiment que seule la science permet une ascension. J’ai trouvé que l’opposition math-lettres était surannée, ça m’a parfois dérangé et ennuyé. La narration suit donc le parcours de ces jeunes femmes, parcours professionnel et amical. J’ai aimé leur relation fusionnelle mais j’ai aimé aussi quand l’amitié est en pause, il y a des grandes périodes de silence complet entre les deux amies et puis leur relation reprend. J’aurais aimé comprendre davantage pourquoi il y a des pauses. Très vite on comprend que la relation est aussi une relation de concurrence, de compétition. Elles sont brillantes toutes les deux mais la réussite ne se manifeste pas de la même manière en littérature et en mathématiques. Adèle rêve de médailles pour ses recherches et de publication. J’ai trouvé la construction de l’histoire très confuse. On parle de leur parcours professionnel, personnel, amical… il est aussi question de suicide et de réussite. En effet le roman débute ainsi « Adèle pendue comme un homme ». Et puis il y a aussi cette opposition continuelle dans tout le récit entre les mathématiques et la littérature, le masculin et le féminin. Comme si cela pouvait avoir un lien… j’ai trouvé cela désuet. Finalement c’est Adèle qui se construit une famille, mais se tuerait-elle d’être le fils qu’elle aurait dû être ? Et pourtant « la fille parfaite », c’est elle puisqu’elle a choisit les mathématiques, les sciences, la rigueur, la précision, la certitude par opposition aux lettres plus artistique. Bref vous l’aurez compris, je ne suis guère enthousiasmé par ce roman que j’ai trouvé trop confus pour moi, pas assez linéaire et surtout la relation entre les deux protagonistes trop réduite à l’opposition math-lettres.